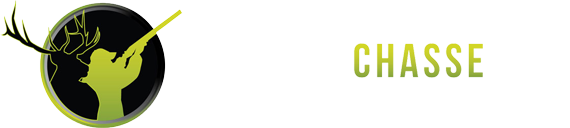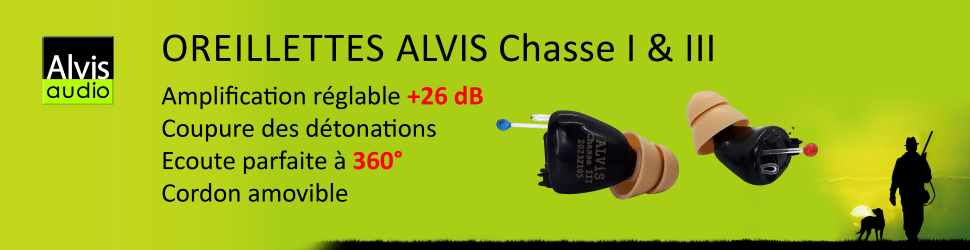Début mars, les députés Emmanuel Blairy (RN, Pas-de-Calais) et Daniel Labaronne (EPR, Indre-et-Loire) ont présenté les conclusions d’une mission flash qui mérite l’attention de tous ceux qui, de près ou de loin, vivent ou font vivre nos territoires ruraux. Lancée en novembre dernier sous l’égide de la Commission du développement durable, cette initiative s’est penchée sur un enjeu aussi brûlant que fondamental : comment permettre aux Français de profiter de la nature tout en assurant sa préservation pour les générations futures.
Depuis la crise du Covid, la fréquentation des espaces naturels a explosé. Promeneurs, cyclistes, cavaliers, chasseurs, naturalistes, sportifs du dimanche ou pratiquants assidus : tout le monde veut sa part de verdure. Mais pendant que les jambes se délient, les chemins, eux, disparaissent. Depuis 1945, la France a perdu quelque 250 000 kilomètres de chemins ruraux. Et pendant que les usages se multiplient, les espaces accessibles, eux, n’ont pas suivi la même courbe de croissance.
C’est dans ce contexte que les deux parlementaires ont sillonné le terrain, multiplié les échanges – vingt-et-une auditions et tables rondes, près de quarante structures rencontrées – pour entendre les préoccupations, les attentes, mais aussi les solutions des acteurs de terrain. Fédérations de chasse, associations de protection de la nature, agences publiques, gestionnaires d'espaces protégés, mais aussi représentants du sport et des loisirs : tous ont eu voix au chapitre.
Le constat est sans appel : la pression sur les milieux naturels s’intensifie. Or, 75 % des forêts françaises sont privées, et une grande partie des espaces naturels appartient à une mosaïque de propriétaires et gestionnaires qui n’ont pas toujours les mêmes intérêts ni les mêmes contraintes. Cette diversité rend indispensable un travail de concertation finement mené au niveau local.
Heureusement, les rapporteurs notent que là où les dialogues s’engagent, ils se déroulent souvent dans un climat constructif. Mais tout n’est pas rose pour autant. Certains points de friction demeurent – entre randonneurs et chasseurs, entre naturalistes et exploitants agricoles, entre pratiques libres et réglementation stricte. Pour apaiser ces tensions et encourager une gestion plus partagée, le rapport avance onze propositions concrètes.
Il ne s’agit pas, insistent les députés, d’opposer les usages, mais bien de chercher une cohabitation intelligente, où chacun trouve sa place dans le respect du vivant. Car derrière ces débats parfois vifs, une réalité fait consensus : sans biodiversité préservée, il n’y aura plus de nature à partager.
La balle est désormais dans le camp des pouvoirs publics, mais aussi des territoires. Car c’est sur le terrain, au plus près des réalités locales, que devront s’écrire les nouvelles règles d’un vivre-ensemble durable entre l’homme et la nature.